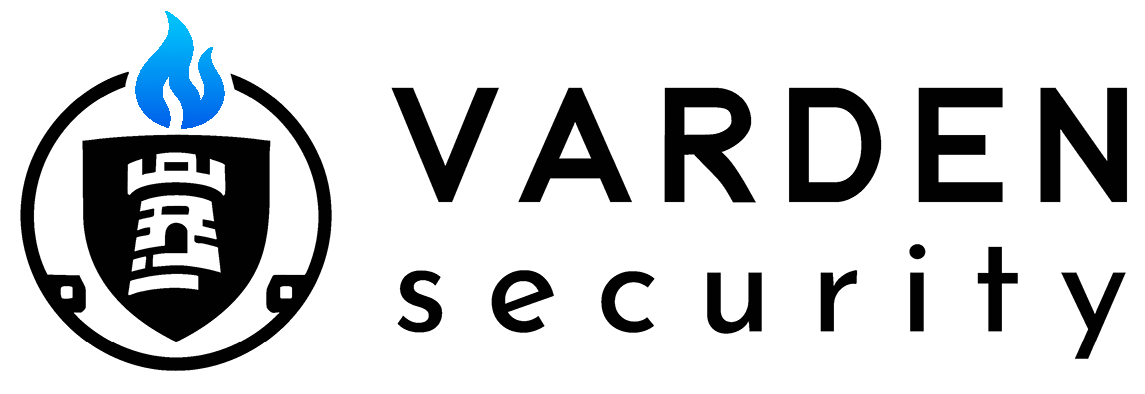En 2025, l’intelligence artificielle ne repose plus uniquement sur des données explicites.
Elle s’épanouit à partir de signaux que nous ignorons émettre — des schémas de comportement, le ton de notre voix, nos habitudes de défilement, les micro-délai dans notre frappe. Ces fragments, assemblés par des modèles d’apprentissage automatique, forment ce que l’on appelle de plus en plus notre « trace numérique ».
Cette ombre numérique n’est pas une simple métadonnée.
C’est une simulation en temps réel de ce que vous êtes, utilisée pour prédire ce que vous ferez, ressentirez ou choisirez.
Et la véritable question aujourd’hui n’est plus de savoir si nous sommes observés, mais bien si nous conservons notre libre arbitre dans un monde où l’IA interprète et agit en notre nom — souvent sans notre connaissance ni notre consentement.
Le profil invisible
Les préoccupations traditionnelles liées à la vie privée portaient sur les fuites de données, les mots de passe piratés ou les cookies intrusifs.
En 2025, la menace est plus subtile et systémique : l’inférence.
Les systèmes d’IA ne se contentent plus de stocker vos données :
ils construisent des profils comportementaux complexes pour anticiper vos décisions.
Qu’il s’agisse d’un service financier évaluant votre solvabilité ou d’un assistant numérique filtrant votre fil d’actualité, ces systèmes s’appuient sur des modèles probabilistes construits à partir de votre exhaust numérique.
Vous n’y avez pas forcément consenti — en tout cas, pas directement.
Mais le simple fait d’être en ligne entraîne mécaniquement ces modèles.
Le consentement par défaut
La collecte de données par les plateformes a évolué :
elle est passée d’un opt-in explicite à une passivité par défaut.
Les politiques de confidentialité sont opaques, les formulaires de consentement volontairement ambigus, et l’inférence algorithmique est rarement encadrée par la loi.
Pire encore, l’émergence d’analyses générées par l’IA — des scores de personnalité aux prédictions en santé mentale — crée une zone grise :
même si les données brutes vous appartiennent, les interprétations aussi ?
Dans la plupart des cadres juridiques, la réponse est floue.
Le RGPD, par exemple, régule les données personnelles, mais dit peu de choses sur les traits inférés ou les prédictions algorithmiques.
Ce vide juridique expose les utilisateurs à une nouvelle forme de colonialisme des données — où des machines extraient de la valeur à partir de notre comportement, sans que nous n’ayons jamais vu la carte.
La propriété algorithmique
Qui possède votre trace ?
-
Les courtiers en données disent : « c’est anonymisé ».
-
Les plateformes disent : « ce sont des inférences, pas des données ».
-
Les régulateurs disent : « nous travaillons dessus ».
Pendant ce temps, le profilage prédictif redéfinit l’accès à l’emploi, le scoring de crédit, les tarifs d’assurance ou le ciblage politique.
Une IA que vous ne rencontrerez jamais prend des décisions basées sur une version de vous qu’elle a elle-même construite —
un jumeau probabiliste que vous ne pouvez ni auditer ni corriger.
Ces profils IA doivent-ils être reconnus comme données personnelles ?
Les individus doivent-ils avoir le droit d’y accéder, de les supprimer, ou de les contester ?
Techniquement, c’est possible. Éthiquement, c’est indispensable. Légalement, nous sommes en retard.
Une voie à suivre
Des solutions émergent :
-
Apprentissage fédéré
-
Confidentialité différentielle
-
Coffres-forts de données contrôlés par l’utilisateur
Mais le vrai défi n’est ni technique, ni juridique :
il est politique et culturel.
Nous devons repenser la notion d’agence numérique.
Le consentement ne peut être passif.
Le profilage ne peut être invisible.
L’IA ne peut pas agir en votre nom sans mécanisme de contrôle ou de recours.
Concevoir une véritable transparence impose de réinventer le design des interfaces, les modèles économiques et la gouvernance des données.
Cela signifie outiller les citoyens — pas seulement les entreprises — pour qu’ils puissent gérer leur présence numérique.
Conclusion : la nouvelle frontière des droits numériques
En 2025, les droits numériques ne se résument plus à ce que vous partagez consciemment.
Ils concernent ce que d’autres déduisent, synthétisent et exploitent — à partir des ombres que vous ignoriez avoir laissées derrière vous.