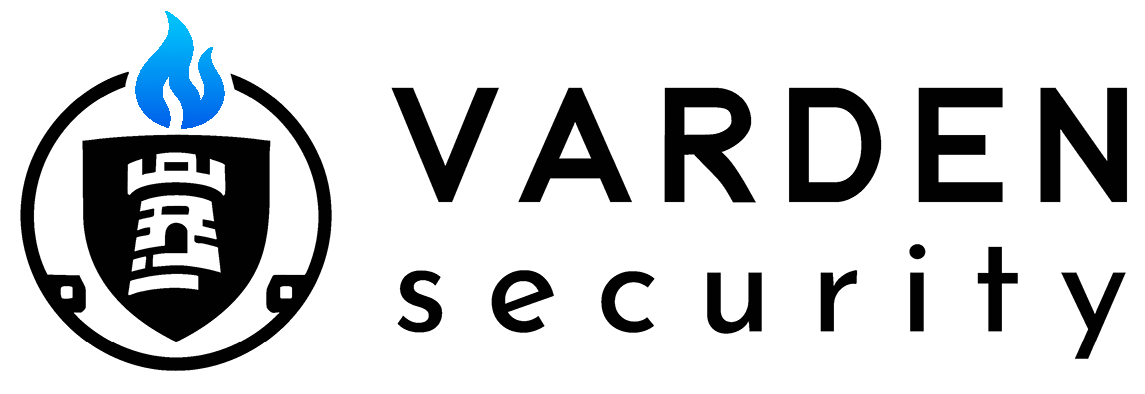La cybersécurité, un tremplin pour les talents atypiques
La cybersécurité est devenue l’un des enjeux majeurs de notre époque. Chaque jour, les entreprises font face à des attaques toujours plus sophistiquées, et les besoins en protection numérique explosent. Pourtant, un paradoxe persiste : malgré la multiplication des formations et des annonces d’emploi, les postes peinent à trouver preneurs. On parle de milliers de places vacantes en Belgique et en Europe. Pourquoi ? Parce que trop souvent, les filtres de recrutement restent figés sur un modèle unique : diplômes académiques, parcours linéaires, expériences validées. Et si cette vision était trop étroite ? Et si la cybersécurité avait justement besoin de talents venus d’ailleurs, de profils autodidactes, atypiques, parfois inattendus ?
Quand la compétence dépasse le diplôme
Dans le monde numérique, ce ne sont pas toujours les diplômes qui font la différence, mais la curiosité, la passion et la capacité à apprendre vite. Combien de jeunes passionnés ont appris à sécuriser des systèmes en explorant par eux-mêmes, en contribuant à des forums spécialisés ou en participant à des compétitions de hacking éthique ? Combien d’autodidactes passent leurs soirées à décortiquer des lignes de code, à tester des scénarios d’attaque et à comprendre, par l’expérience, ce que d’autres mettent des années à théoriser ? Ces profils existent. Ils sont compétents. Mais trop souvent, on les écarte, faute de diplôme estampillé d’une grande école.
Réduire la cybersécurité à une liste de certifications, c’est passer à côté d’une ressource précieuse : la créativité. Un bon professionnel de la cybersécurité, ce n’est pas seulement quelqu’un qui connaît les normes, mais quelqu’un qui anticipe, qui improvise, qui sait se mettre dans la tête d’un attaquant pour mieux protéger. Et ces qualités se développent aussi bien dans un parcours académique que dans l’autodidaxie passionnée.
L’exemple britannique : transformer des trajectoires de vie
Le Royaume-Uni a montré qu’il est possible d’aller encore plus loin. Ces dernières années, plusieurs programmes pilotes ont été lancés dans les prisons pour former des détenus à la cybersécurité. L’idée peut surprendre, mais les résultats parlent d’eux-mêmes. Certains prisonniers, parfois condamnés pour des délits liés à l’informatique, avaient déjà des compétences impressionnantes. D’autres ont découvert dans la cybersécurité une véritable vocation. Encadrés, accompagnés, ces profils se révèlent motivés, rigoureux et extrêmement loyaux envers les entreprises qui leur donnent une chance.
Ce modèle est inspirant : il prouve que même dans les contextes les plus éloignés du marché du travail traditionnel, il est possible de révéler et de valoriser des compétences utiles à la société. Si l’on peut faire confiance à des personnes en réinsertion, pourquoi continuer à fermer la porte à des candidats “hors norme” qui, sans diplôme, ont pourtant les qualités nécessaires pour réussir ?
Une richesse pour les entreprises
Donner leur chance à ces profils atypiques n’est pas une option par défaut face à la pénurie : c’est une véritable opportunité. Ces talents apportent un regard neuf, une capacité d’adaptation et une créativité que l’on retrouve moins chez des profils formatés. Ils savent communiquer, vulgariser, ou gérer des situations inédites, parce qu’ils viennent d’autres horizons : enseignement, artisanat, armée, commerce, ou même parcours autodidacte pur.
Pour les entreprises, c’est un pari qui rapporte. Non seulement elles comblent un besoin critique, mais elles renforcent aussi leur culture interne. Ces collaborateurs, conscients de la chance qui leur est donnée, font souvent preuve d’une loyauté rare. Dans un secteur où la confiance et la résilience sont des valeurs cardinales, c’est un atout immense.
Ouvrir les portes, changer les regards
La pénurie de talents en cybersécurité ne sera pas résolue uniquement par les universités ou les certifications prestigieuses. Elle passera par un changement de mentalité : accepter que la compétence se prouve autrement que par un diplôme, créer des parcours de reconversion accessibles, valoriser l’expérience pratique et la passion. Dans une société plurielle, il est urgent de sortir du réflexe “diplôme à tout prix” et d’ouvrir d’autres chemins vers la réussite professionnelle.
Cela suppose aussi une évolution de l’éducation. Les compétences numériques et la sensibilisation à la cybersécurité devraient être présentes dès l’école primaire, pour donner le goût et les bases à tous les enfants. Mais cela ne doit pas se traduire par l’obligation d’un long parcours universitaire. Cinq ans sur les bancs d’une faculté ne sont pas le seul moyen d’accéder à ces métiers. Des formations plus courtes, plus pratiques et mieux intégrées dans le tissu économique doivent permettre à chacun de trouver sa place, qu’il soit étudiant, en reconversion ou autodidacte.
En ouvrant la cybersécurité à des talents atypiques, nous faisons plus que combler des postes. Nous renforçons la diversité, nous enrichissons la réflexion stratégique et nous offrons à des individus une vraie place dans la société numérique. La cybersécurité est un enjeu collectif : elle mérite que l’on mobilise toutes les énergies, y compris celles qui ne rentrent pas dans les cases traditionnelles.